Toujours d’actualité. L’autisme aujourd’hui : abord clinique. Rapport du docteur Daniel ROY.
Décembre 2023
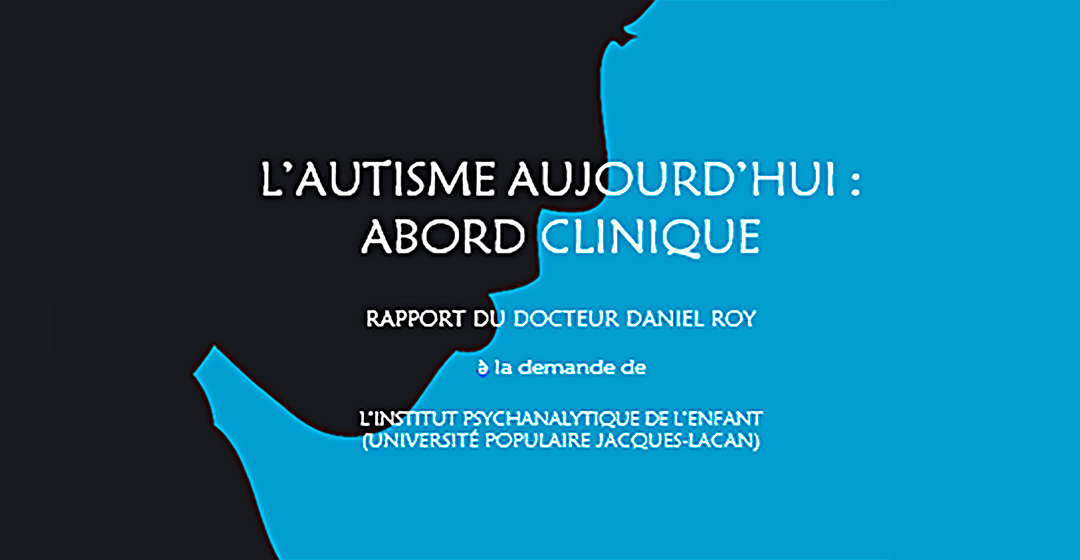
- L’ABORD CLINIQUE DE L’AUTISME
- 1.1 – L’autisme est d’abord une énigme
L’autisme infantile est apparu d’emblée pour les praticiens comme une énigme, car témoignant de la position de sujets qui semblaient se défendre massivement de tout ce qui constitue la spécificité des êtres parlants.
Des traits surprenants :
- se tenir à distance du langage, ou alors vider le langage de sa dimension énonciative ;
- sembler préférer l’immuabilité au changement, au point de s’automutiler ou d’agresser un autre corps en cas de modification, quelquefois extrêmement ténue, de l’environnement ;
- sembler refuser tout contact avec les autres, avec les proches en particulier, et préférer les contacts avec des objets inanimés, ou des animaux, ou des ensembles finis de représentations – livres, dessins animés, jusqu’à des pans entiers de savoir constitué ;
- être très embarrassés par les grandes « fonctions de relations » humaines : manger – être nourri, se nourrir –, se séparer de ses déchets – selles, urines –, regarder, être regardé, entendre, se faire entendre ; préférer quelquefois de « nouvelles » fonctions – régurgiter, baver, « plafonner », effectuer des gestes ou des séquences motrices « étranges ».
D’où pouvait bien s’originer une telle position qui semblait négativer point par point chacune des conquêtes qui sont celles de l’enfant qui grandit ?
- 1. 2 – La recherche de la cause
Les psychanalystes ont été les premiers cliniciens à accueillir les enfants autistes. Ils ont modifié leur pratique en adaptant cet accueil aux sujets autistes. Dans le même temps, ils ont forgé des concepts pour tenter de rendre compte, avec le corpus théorique propre à chacun, de cette énigme absolue que constitue la position du sujet autiste. Ils ont été de ce fait les premiers à expérimenter le caractère périlleux de vouloir répondre à la question de la cause, d’où la grande variété des théories qui se sont attachées à la recherche de la cause de l’autisme.
Ces essais théoriques n’ont jamais été détachés d’un engagement des praticiens auprès des sujets autistes et de leurs familles. On en voudra pour preuve, avant même que l’autisme soit isolé comme catégorie clinique, la mise en regard des affrontements terrifiants élaborés par une Mélanie Klein pour rendre compte des premières rencontres avec de jeunes patients extrêmement souffrants, et de l’accueil tout de délicatesse et de tact de l’enfant et de ses proches au cours du traitement.
Les psychanalystes ont appris à laisser la question de la cause sans réponse dans leur travail avec les sujets autistes, de la même façon que pour leur travail avec tout autre sujet. Cela n’empêche pas qu’ils poursuivent leurs élaborations de savoir pour border l’énigme que constitue l’autisme : il n’y a pas là effets de « chapelles », voire de « sectes », car la psychanalyse n’est pas la religion du psychisme, mais tentatives, pour chaque praticien, de forger des outils « à sa main » pour s’affronter à l’inconnu.
C’est ce que nous appelons « l’abord clinique de l’autisme ».
- 1.3 – Qu’est-ce que l’abord clinique de l’autisme ?
Le point de départ de cet abord est simple : il prend appui sur la rencontre.
Or l’intense difficulté, voire souffrance, de l’enfant autiste face à la rencontre, va dès un premier rendez-vous orienter le clinicien vers le diagnostic d’autisme.
Dans cette perspective, l’autisme se présente comme « une pathologie de la rencontre », aux deux sens du terme :
- le sujet autiste pâtit de la rencontre avec l’autre ;
- la rencontre en souffre, c’est-à-dire se trouve alors « attaquée » par l’enfant, et au minimum refusée, ce que tous les intervenants auprès de personnes autistes ont pu expérimenter.
Tenir compte de la défense
C’est cette dernière dimension qui, d’être ignorée pour ce qu’elle est – une défense –, induit une perspective fâcheuse, celle de prêter à l’enfant une intention, une volonté de refus, que l’on va vouloir alors forcer ou apprivoiser par des méthodes où il s’agit que l’enfant se plie à une volonté qui lui est étrangère.
Pour ne pas étendre le domaine de l’autisme
Ce qui est là inaperçu, c’est que les acteurs de ces méthodes viennent incarner alors le processus autistique lui-même et en deviennent les agents. Le processus est alors sans fin, en extension permanente, et prend le relai du système autistique du sujet : toujours plus d’impératifs, toujours plus d’accompagnants, toujours plus de financements. Ces procédés vampirisent la famille quand elle s’y prête : père, mère, les autres enfants, les voisins, les grands-parents, les jeunes psychologues et éducateurs en recherche d’emploi, tous sont sensibilisés et mobilisés dans ce qui apparaît comme une extension du domaine de l’autisme.
Pour ne pas étendre le domaine du conditionnement
Il est indéniable que ces méthodes de conditionnement comportemental ont des effets : l’enfant se pliera à des comportements plus adaptés socialement, jusqu’à des possibles intégrations scolaires et professionnelles adaptées. Il y aura atteint par un conditionnement aussi implacable que son « monde autistique », et qui s’y sera substitué. Les tenants de ces méthodes invoquent l’éducation de l’enfant dit « normal » comme processus de conditionnement…
- 1.4 – Les fondements de l’efficacité de l’abord clinique de l’autisme
La rencontre avec cet enfant-là : les premiers traits dégagés dans la rencontre formeront les appuis solides sur lesquels le clinicien pourra fonder son action auprès de l’enfant et avec l’enfant. Cet abord s’oppose point par point à une approche où est privilégiée une objectivation des symptômes à partir d’une grille préalable d’items, approche qui, de façon imparable, majore les dits-symptômes quand le sujet est mis en position d’objet d’observation ou d’étude.
Le clinicien est partie prenante de la rencontre, sa responsabilité est engagée dans la façon même dont il accueille les difficultés de l’enfant et les questions des parents.
L’enfant autiste : un sujet au travail
L’enfant arrive avec ses défenses, qu’il a élaborées et qui lui ont été utiles, même si elles apparaissent aujourd’hui comme inadéquates, dispendieuses en énergie pour l’enfant, sources de désagréments pour les parents et la famille, quelquefois jusqu’à l’insoutenable. Avec les parents, avec l’enfant, c’est-à-dire en suivant la voie que celui-ci indique par ses attitudes, ses paroles, ses mimiques, le praticien suit pas à pas l’édification de ces constructions de l’enfant et en fait le récit en en cherchant la logique. Les parents peuvent alors reconnaître dans cette logique nombre d’attitudes ou de situations restées mystérieuses.
Ce qui est insupportable pour l’enfant dans la rencontre : le regard ? la voix ? l’arrêt d’une séquence ? une soustraction ou un manque aperçu dans l’environnement ? À partir de ces repères, le clinicien pourra ainsi adapter sa présence au côté de l’enfant : regarder ailleurs, murmurer, élaborer avec l’enfant des rituels d’entrée et de sortie, vérifier que les comptes soient justes. Déjà nous voyons le praticien prendre à son compte et « traiter » une grande partie des « forces » des êtres vivants et parlants qui sont là en présence. C’est sur cette opération que repose une grande partie de l’efficacité de l’abord clinique.
Les événements de corps et les inventions de médiation
Mais il y a aussi dans cette rencontre des événements qui semblent procurer à l’enfant une satisfaction indicible, qui souvent est difficilement supportable par l’entourage. Quel statut leur donner ? Quelle attitude adopter ?
Tous ces événements ne sont pas du même ordre : certains sont directement en prise sur le corps, d’autres surviennent grâce à une médiation, souvent par un « objet autistique » permanent ou éphémère, qui assure une première condensation hors du corps. Cette « solution spontanée » indique au praticien la voie, qui consiste à chercher avec l’enfant le type d’objet, de trace, de bricolage, dont il va pouvoir se saisir pour réaliser une médiation maniable entre lui et l’autre, pour réaliser une première séparation entre le corps et cet envahissement par une satisfaction étrange – celle de la bouche, celles des excrétions, celles du regard et de la voix, la jouissance masturbatoire.
- 1. 5 – Comment s’évalue l’abord clinique de l’autisme ?
Un consentement à la présence
La pertinence de cet abord clinique, qui prend en compte les conditions initiales de la rencontre avec le sujet autiste, s’évalue par le consentement progressif de l’enfant à la présence du ou des intervenants, en tant qu’ils prennent soin de lui.
Modification des conditions de l’échange
C’est en effet ce que le sujet autiste a le plus de mal à accepter : passer, comme tout enfant qui grandit, par les conditions de l’échange – échange de paroles, de regards, d’objets, de sourires, etc. – avec les personnes qui lui portent un intérêt particularisé, en règle générale les parents et les membres de la famille. De ce fait, ce qu’il est convenu d’appeler « le traitement » consiste pour les intervenants à modifier de leur côté ces conditions de l’échange : à proprement parler, c’est donc leur mode de présence qu’ils « traitent » et non pas celui de l’enfant.
Des résultats
Les résultats de l’abaissement drastique des contraintes de la demande sont, dans un premier temps, spectaculaires : arrêt des auto- ou hétéro-agressions, apaisement des stéréotypies, élargissement des intérêts de l’enfant. Dans un second temps, un long trajet se met en place où s’élabore un équilibre complexe entre le « système » autistique – qui relève d’une grande logique formelle –, et le consentement de l’enfant à y intégrer « une dose de vivant », en prenant appui sur la confiance qu’il prend dans les intervenants qui l’accompagnent. Ce temps de travail est heureusement ponctué par les trouvailles et inventions originales du sujet, qui sont autant de créations stables et dignes de valeur pour le sujet lui-même et pour l’entourage.
Des souffrances nouvelles
L’ouverture au monde est aussi douloureusement ponctuée par moments de souffrance de l’enfant, à chaque fois qu’il rencontre un événement potentiellement inacceptable dans son « système autistique » : événements à haute valeur symbolique – naissance, décès d’un proche, catastrophe naturelle, séparations –, événements du corps – douleurs, maladies, puberté…
Un travail à plusieurs
L’abord clinique est une évaluation en acte, en cela qu’elle consiste à régler chacune de ses actions sur ses effets immédiats et médiats. Ce feed-back est toujours présent, et encore plus sensible dans les institutions qui mettent en place un « travail à plusieurs », c’est-à-dire où les intervenants s’autorisent à se « traiter les uns les autres », pour créer autour de l’enfant un environnement à la fois réglé, chaleureux et plein de surprises. Une évaluation digne de ce nom n’a nul besoin de se parer des oripeaux du management, des objectifs de qualité et de grilles d’expertise, pour permettre aux intervenants d’apprécier à tout moment la justesse et l’efficacité de leur action, pour en rectifier les modalités si nécessaire, pour préserver la part d’énigme et de non-savoir au cœur de toute rencontre.
- 1. 6 – L’obstacle du symbolique et ses conséquences
Nous ne traitons pas l’autisme comme une maladie au sens médical du terme, même s’il arrive que telle ou telle souffrance nécessite une aide médicamenteuse.
Nous ne le traitons pas non plus comme un handicap, même s’il est absolument légitime que les personnes autistes bénéficient de l’ensemble des dispositions de la loi de 2005 sur le handicap.
Nous traitons l’autisme à partir de l’obstacle que constitue pour lui le symbolique. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu’un sujet autiste se tient à la plus grande distance possible des liens et des places symboliques, tels qu’ils sont mis en fonction par le langage, dans tous les systèmes d’échanges et de dons, de gains et de pertes, dans les systèmes d’alliance et de filiation qui régissent les sociétés humaines. C’est ce qui fait que les sujets autistes se présentent avec une « infirmité » du lien social, s’y déplaçant avec prudence, voire méfiance, prompts à s’isoler si l’autre se fait insistant. Mais s’il est possible de prendre des mesures de protection contre un empiétement extérieur, il est bien plus complexe de se débrouiller avec les phénomènes qui affectent le corps ou le « mental ».
L’autisme, psychose ou TED ?
- Développement et apprentissages
Concernant ce qu’il est habituel d’appeler le « développement », l’enfant autiste l’aborde avec les stratégies qui sont celles qu’il a élaborées : ses apprentissages sont marqués par l’évitement de ce qui est au principe du système symbolique, à savoir que le mot est substituable à la chose, et ceci de façon non univoque. L’enfant autiste va donc privilégier des systèmes d’apprentissages :
- qui ne reposent pas sur la demande : plutôt la trace écrite que la langue parlée ;
- qui fonctionnent de façon bi-univoque ;
- qui proposent un traitement de la signification par l’image ;
- qui proposent des ensembles finis, limités, non soumis à l’intervention d’un autre ;
- qui servent certains « intérêts » du sujet, en particulier ce qui lui fait problème dans le fonctionnement du corps vivant.
La dénomination de « trouble envahissant du développement » est donc mal formée pour désigner de façon dynamique ce qui est à l’œuvre dans l’évolution du sujet autiste dans le temps de l’enfance et de l’adolescence : elle le fige de façon statique dans une symptomatologie d’observation et d’objectivation.
- Psychose et phénomènes envahissants
La notion de « psychose infantile » répond à d’autres difficultés que rencontre le sujet autiste, celles que nous avons désignées comme « phénomènes qui affectent le corps et le mental ». En effet, de longue date, les cliniciens ont pu constater l’apparition de phénomènes d’envahissements xénopathiques du corps ou de la pensée : devenir-robot, devenir-animal, hallucinations, perplexité anxieuse. Ces phénomènes ont été alors rapprochés d’autres tableaux de psychose infantile et des sujets autistes témoignent de ces phénomènes et les localisent. La notion de psychose, utilisée par les cliniciens pour rendre compte de phénomènes attestés par les sujets eux-mêmes, est ainsi respectueuse de ce à quoi certains sujets autistes sont confrontés dans leur évolution. Elle permet de prendre en compte les souffrances de sujets lourdement affectés par le processus autistique. Néanmoins, elle ne paraît plus adéquate dans le débat actuel concernant « les autismes ».
- 1. 7 – Les parents et la famille
Retrait et étrangeté
La position de l’enfant autiste, son retrait de la relation, son éventuelle « étrangeté », présente dès les premiers jours ou se révélant aux parents dans la petite enfance, mettent la mère, le père et l’entourage familial dans une situation spécialement complexe, dans le mouvement de s’adapter à ce nouveau-né « différent », à ce jeune enfant qui très tôt présente des intérêts inhabituels.
La découverte des marques de la différence
Très fréquemment, les parents d’un enfant autiste relatent le moment précis où, l’enfant ayant été confié pour la première fois à une autre personne de l’entourage, ils découvrent lors des retrouvailles « un autre enfant », les marques de sa différence leur apparaissant alors de façon souvent très douloureuse. Ce moment est fondamental pour deux raisons :
- il indique ce fait troublant que le système autistique de l’enfant peut configurer, quelquefois de façon très déployée, le mode de vie parental et familial, jusqu’à ce que l’enfant se trouve confronté à un autre « régime de socialité », crèche, école maternelle, ou quelquefois simple remarque d’un tiers ;
- il éclaire tout le débat sur « le diagnostic précoce de l’autisme » et sa difficulté, les parents préférant indexer les traits singuliers, qu’ils constatent ou qui leur sont renvoyés par le milieu extérieur, par d’autres dénominations que leur fournit la grande encyclopédie du discours courant : « hyperactif » si l’agitation est au premier plan, « précoce » ou « surdoué » si un intérêt cognitif spécifique est au premier plan.
« Distance » et « fusion »
Un autre point douloureux pour les parents relève de la distance, voire la défense, que l’enfant manifeste par rapport aux liens « symboliques » qui unissent les membres de la famille, tels qu’ils sont désignés traditionnellement par l’amour parental et filial. L’enfant autiste se dispose en effet selon deux grands axes : un apparent manque d’affect dans la relation d’un côté, et de l’autre une grande proximité corporelle, sur le mode d’un « branchement » sur le corps de l’autre. Ces deux traits induisent un mode de relation soit très « distant », soit très « fusionnel », entre les parents et l’enfant, qui ont été à l’origine de bien des confusions dans les perspectives prises sur les difficultés rencontrées au quotidien par les parents.
Le cas par cas
L’abord clinique de l’autisme impose au praticien et aux divers intervenants :
- un cheminement au cas par cas dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’annonce du diagnostic », moment où il s’agit très concrètement pour un père et une mère de se confronter à la perspective que leur enfant est porteur d’une marque de différence, perspective à laquelle nul n’est préparé, irruption d’un point réel désormais incontournable ; il n’est pas rare que cette annonce, quelle qu’en soit la forme, provoque une réaction initiale de rejet ;
- la recherche de solutions adaptées et supportables par la famille face à une situation qui est socialement marquée du « handicap » ou de la maladie, qu’elle soit dite « mentale », « psychique » ou « neuro-développementale » ;
- un accompagnement au long cours qui prenne en compte les ressources et les disponibilités des membres de la famille, qui trouvent et inventent des solutions originales dans la vie quotidienne avec leur enfant.
-
- 1.8 – « Les autismes »
La situation clinique des enfants, adolescents et adultes autistes est extrêmement variable et conditionne grandement les perspectives de soins et d’accueil institutionnel.
Les nouvelles modalités de prise en charge ont également modifié les « tableaux cliniques » : les traitements en hôpitaux de jour ont le plus souvent permis d’enrailler les évolutions déficitaires qui étaient de règle auparavant ; les méthodes « intensives » d’apprentissage déplacent l’impact du processus autistique et, prescrivant des intégrations sociales nouvelles, font surgir de nouvelles difficultés pour le sujet autiste.
Au milieu de ces reconfigurations du « spectre de l’autisme », deux éléments nous apparaissent essentiels pour apprécier les perspectives évolutives :
- l’usage ou non du langage, qui, même dans une version écholalique, mécanisée, stéréotypée, recèle néanmoins de possibles surprises pour le sujet autiste et permettent à ceux qui l’accueillent d’entrer dans un malentendu salutaire ;
- l’usage de la trace, de la lettre, de l’écriture, qui fournit des ressources singulières au sujet autiste pour contourner « l’obstacle du symbolique ».
Mais, en ces points, c’est encore la dimension de la rencontre qui sera décisive : tel parent, tel intervenant va saisir un signe ténu, une trace infime, comme signe d’un sujet, et va permettre ainsi à l’enfant de s’ancrer un tant soit peu dans le monde commun partagé.
- 1.9 – Le sujet autiste
Témoignages
Depuis Kanner et Asperger, les cliniciens sont particulièrement sensibles à ce que les sujets autistes eux-mêmes énoncent de leur position. Ce mouvement s’est accentué, pour entrer dans le discours public, en particulier grâce à des ouvrages écrits par des sujets autistes, quelquefois avec également le témoignage de leur entourage.
Gel
L’abord clinique de l’autisme met la question du sujet au centre de son action : il suppose en effet que l’immuabilité et la recherche de solitude de l’enfant autiste sont le témoignage d’une « pétrification », d’un « gel » de cette question du sujet, telle que la psychanalyse la repère au cœur des embarras, des empêchements, des symptômes des êtres parlants.
Férocité
L’abord clinique de l’autisme élabore donc des tactiques et des stratégies qui respectent cette place du sujet et qui tentent de tenir à distance la férocité des contraintes que le système autistique fait peser sur cette place.
Grain de sel
L’abord clinique de l’autisme envisage avec enthousiasme tout ce que le sujet autiste invente pour moduler, diffracter, localiser, nommer, inscrire, l’impact des contraintes externes et internes. Il privilégie ces initiatives, sans pour autant se priver d’aller y mettre « son grain de sel » ! C’est ainsi que s’est progressivement élaborée l’action des praticiens auprès des sujets autistes et de leur famille.
- NOTRE ACTION POUR LES SUJETS AUTISTES ET LEUR FAMILLE
- 2.1 – Rappel historique : l’avance française
Rappelons qu’en France, à partir des années 60-70, ce sont les psychiatres d’enfant et les psychologues formés à la psychanalyse qui commencent à se préoccuper du sort des enfants autistes jusqu’alors placés en hôpital psychiatrique ou en institution fermée, où la dimension déficitaire était prépondérante. Ils prennent appui sur les psychanalystes anglo-saxons Frances Tustin, Margaret Malher, Donald Meltzer, sur la création d’un premier hôpital de jour pour enfants dans le XIIIe arrondissement à Paris et sur l’institution de Maud Mannoni « l’École expérimentale de Bonneuil », avec les travaux de Rosine et Robert Lefort, élèves de J. Lacan. L’ensemble de ces travaux donne aux praticiens – psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs, orthophonistes, psychomotriciens – l’idée d’un traitement possible et d’apprentissages qui tiennent compte du symptôme du sujet, au-delà de la coercition.
Les hôpitaux de jour, dans le mouvement de sectorisation de la psychiatrie, se créent dans cette perspective. Il s’agit d’offrir un accueil qui ne soit pas basé sur le déficit et qui tienne compte de la particularité de chaque sujet. La situation familiale fait partie de cette particularité, car les constellations familiales sont loin d’être toutes identiques. Les parents sont reçus, écoutés. Les enfants, les adolescents, sont reçus dans des petits groupes, sollicités pour des « ateliers » où peuvent se décliner leurs intérêts. Dans les moments de repas, de jeux, d’étude, ils expérimentent de nouveaux rapports avec les objets et avec les demandes, avec ce qui structure le monde de tous les enfants, mais dont les enfants autistes se défendent.
. 2.2 – La place de la psychanalyse
Cette longue expérience de diagnostic, d’accompagnement des familles, de mise en place de parcours spécialement tissés pour chacun, a fait l’objet de nombreuses publications et de recueil de travaux. Elle n’aurait pas pu se soutenir sans la référence quotidienne à la psychanalyse, à son corpus textuel, à son enseignement vivant.
Comment situer aujourd’hui la place de la psychanalyse dans le traitement de l’enfant autiste ? Nous proposons 5 axes de réponse :
- La formation analytique, c’est-à-dire l’expérience d’une psychanalyse personnelle, donne aux intervenants un outil puissant pour situer leur action auprès des sujets autistes à la bonne distance, en se tenant à distance d’idéaux de normalisation ou de normalité incompatibles avec l’accompagnement professionnel de sujets en souffrance. Elle n’est pourtant pas une condition préalable pour cette intervention.
- Le respect de la position du sujet est la boussole qui oriente cette action. Il ne s’agit en aucun cas de laisser l’enfant, l’adolescent, être le jouet par exemple de ses stéréotypies, répétitions, écholalies, mais, en les considérant comme un premier traitement élaboré par l’enfant pour se défendre, d’y introduire, dans une présence discrète, des éléments nouveaux qui vont complexifier « le monde de l’autisme »
- La localisation de l’angoisse: L’enjeu est d’abord que puisse se localiser pour l’enfant l’angoisse ou la perplexité que déclenche en lui l’interpellation d’un autre et la mise en jeu des fonctions du corps dans leur lien avec cette demande – se nourrir et se laisser nourrir, perdre les objets urinaires et anaux, regarder et être regardé, entendre et se faire entendre. Les psychanalystes ont depuis longtemps noté la dimension de rituels d’interposition que constituent de nombreux traits symptomatiques invalidants. La création ou la découverte par l’enfant d’un « objet autistique », quelle qu’en soit la forme, est souvent une ressource féconde pour créer des liens et des espaces nouveaux, plus libres des contraintes « autistiques ».
- Un rapport privilégié au savoir: les psychanalystes privilégient l’inscription des enfants autistes dans des dispositifs d’apprentissage. Ils mettent en valeur que le sujet autiste est déjà bien souvent « au travail ». Les autistes dits « de haut niveau » témoignent en ce domaine d’un investissement massif de la pensée, du langage, et du domaine cognitif, où ils trouvent des ressources inédites. Plus généralement, pour tous les enfants, les praticiens cherchent à privilégier les approches pédagogiques et éducatives qui savent s’adapter pour faire une place aux singularités sociales et cognitives des enfants autistes. Les enseignants et les éducateurs témoignent de ce qu’ils ont élaboré avec l’enfant ou l’adolescent.
- Une opposition déterminée aux méthodes de conditionnement: les psychanalystes s’élèvent avec la plus grande force contre des méthodes dites « d’apprentissage intensif », qui sont en réalité des méthodes de conditionnement comportemental, qui utilisent massivement le lobbying, voire l’intimidation, pour promouvoir des « prises en charge » totalisantes, qui s’autoproclament seul traitement valable de l’autisme. Loin de cette réduction, il faut différencier les différentes approches de l’apprentissage. Les psychanalystes et les intervenants, regroupés au sein de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, représentant toutes les catégories professionnelles présentes dans le champ de l’enfance, se déclarent tout spécialement attachés, pour les enfants et adolescents autistes, aux systèmes de soin et d’éducation existant en France, tant qu’ils permettent de répartir les responsabilités respectives et différenciées entre les professionnels du soin, de l’éducation, et les parents.
- 2.3 – Du bon usage des classifications
Ces catégories diagnostiques sont instables
Les classifications actuelles des troubles mentaux – spécialement le DSM – jettent une grande confusion dans le débat, faisant apparaître au même niveau diagnostic des symptômes de l’enfance tels que le bégaiement ou l’énurésie, des « troubles » référés à une normalité sociale (tels que les « troubles oppositionnels avec provocation » ou les « troubles des conduites »), et l’autisme (« trouble autistique »). L’autisme – et ses diverses – se trouve ainsi isolé comme le seul véritable tableau clinique de la catégorie « Troubles envahissants du développement ». Les débats en cours sur la continuité du « spectre des autismes », sur l’opportunité de maintenir dans la même série des TED les dits « Asperger », montrent combien cette catégorie est instable.
Nous veillons à ne pas y enfermer enfants et parents
À l’intérieur de ce « spectre », il faut examiner dans le détail les phénomènes d’envahissement du corps et situer les manifestations étranges et inquiétantes dont il est la proie. Les psychanalystes et les nombreux praticiens d’orientation lacanienne accompagnent ainsi de nombreux enfants et adolescents dans cette élaboration qui leur permet de garder ou de trouver une place dans le lien social et familial. Les parents peuvent alors s’autoriser à parler de certains traits de leur enfant, d’en saisir la valeur, malgré leur caractère étrange. Ce travail est nécessairement long, car il suppose de prendre en cause une différence de l’enfant qui vient à l’encontre des attentes et des désirs qui entourent sa présence au monde. Le psychanalyste, en place de recueillir cette souffrance, doit être attentif à la souffrance des parents et les soutenir dans leur épreuve.
- 2.4 – Du bon usage de l’étiologie
Des hypothèses non vérifiées
Des hypothèses étiologiques multiples – génétique, vaccinale, neurocognitive, etc. – présentées comme des vérités scientifiques à la suite souvent d’un unique article paru dans une revue, dont on apprendra quelques mois ou années plus tard le caractère biaisé, circulent dans les divers médias et affolent les familles. Ces hypothèses causales viennent répondre strictement à la réduction de l’autisme à un trouble du développement, présenté comme une maladie génétique, voire épidémique.
Le « handicap » est un droit social, non une catégorie clinique
Elles se confortent de la loi de 2005 sur le handicap, qui ne vise pourtant aucunement à porter une sentence du type « C’est un handicap, donc cela n’est pas une maladie
», mais à permettre une orientation adaptée pour l’enfant et une aide pour la famille. Beaucoup sur ce point reste à faire, et les associations de parents sont une force indispensable et incontournable pour faire avancer des projets adaptés, en particulier pour les très jeunes enfants et pour les grands adolescents et les jeunes adultes.
Une « grande cause nationale » n’est pas au service d’une cause partisane
L’annonce de l’autisme comme grande cause nationale ne peut que réjouir tous ceux qui sont mobilisés dans les soins apportés aux enfants et adolescents autistes. Il ne conviendrait pas qu’elle se mette au service de lobbies qui œuvrent auprès des médias et de la représentation nationale pour promouvoir une méthode unique, qui cherche à exclure l’abord clinique de l’autisme que prônent la psychanalyse et les praticiens orientés par elle.
- 2.5 – Accompagner le sujet autiste et sa famille
Les psychanalystes suivent tous les débats scientifiques autour des causes de l’autisme infantile. Quelles que soient ces causes, elles ne peuvent réduire le sujet à une mécanique.
Ils prennent en compte les souffrances qu’ils rencontrent et ils promeuvent les institutions et les pratiques qui garantissent que l’enfant et sa famille seront respectés dans le moment subjectif qui est le leur.
Ils facilitent, chaque fois que cela est possible, l’insertion de l’enfant dans des liens sociaux qui ne le mettent pas à mal.
Ils ne sont pas détenteurs d’une vérité « psychologique » sur l’autisme, ils ne sont pas promoteurs d’une « méthode éducative » particulière.
Ils sont porteurs d’un message clair pour le sujet autiste, pour ses parents, et pour tous ceux qui, en institution ou en accueil singulier, prennent le parti et le pari de les accompagner – et les psychanalystes sont de ceux-là : il est possible de construire un autre monde que le monde de défense et de protection où est enfermé l’enfant autiste. Il est possible de construire une nouvelle alliance du sujet et de son corps. L’effort de tous vise à démontrer cliniquement cette possibilité.
Rapport du docteur Daniel Roy à la demande de l’Institut psychanalytique de l’enfant. Mars 2012.